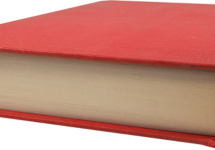Les politiques macroéconomiques semblent inopérantes. La BCE envisage un assouplissement quantitatif, mais on ne peut pas en attendre un impact décisif dans un contexte où les emprunteurs publics les mieux notés lèvent des capitaux sur les marchés au taux de 1% sur dix ans. Même s’il est souhaitable que la BCE s’engage pleinement, il ne faut pas se faire d’illusions sur les effets de son action. Sur le plan budgétaire, les contraintes imposées par le cadre européen, doublées des engagements politiques de retour à l’équilibre budgétaire des gouvernements nationaux – tout particulièrement en Allemagne – limitent leur marge de manœuvre. Au total, la zone euro dispose d’une certaine capacité d’action monétaire et budgétaire pour relancer la croissance, mais trop étroite pour jouer un rôle décisif et, le cas échéant, contrer le risque d’une troisième récession.
Quelles sont les alternatives ? En Europe, l’accent a beaucoup été mis sur les réformes dites structurelles du marché du travail, des conditions de la concurrence, ou de la réglementation des marchés. Depuis le discours de Jean-Claude Juncker devant le Parlement européen, en juillet 2014, et l’annonce qu’il a faite d’un plan de 300 milliards d’euros de dépenses en capital sur trois ans, le thème de l’investissement est également revenu sur le devant de la scène[1]. L’une et l’autre de ces options doivent cependant être examinées de manière précise pour déterminer si et comment elles peuvent concourir au redressement de la conjoncture.
Relancer par la réforme ?
L’idée souvent avancée est qu’une mise en œuvre rapide de réformes économiques permettrait de juguler un chômage persistant et de stimuler une croissance en berne. Puisqu’une action en profondeur est nécessaire, dit-on, elle devrait être entreprise sans délai et contribuerait ainsi à relancer l’activité.
La nécessité de réformes ne fait pas de doute. De longue date, la performance économique de l’Europe est insatisfaisante, que ce soit en matière éducative, dans le domaine de la recherche, sur le front de l’emploi, ou en ce qui concerne l’innovation. La crise financière et les ébranlements macroéconomiques qui lui ont succédé ont souligné le besoin d’une rénovation en profondeur du système économique de la plupart des pays européens. Et il est vrai que ces réformes trop longtemps différées sont devenues urgentes. Il ne résulte toutefois pas de ces constats qu’une action réformatrice aurait immédiatement et mécaniquement un impact positif sur la croissance.
L’opposé pourrait même être vrai. L’expérience suggère par exemple qu’une redéfinition des règles de fonctionnement du marché du travail a souvent dans un premier temps des effets négatifs avant de commencer à produire des bienfaits. Ces politiques ont en quelque sorte le caractère d’un investissement qui coûte avant de rapporter. En temps normal, ce n’est pas très préoccupant : politique monétaire et politique budgétaire peuvent être utilisées pour contrebalancer des effets négatifs de court terme. Dans les circonstances présentes, cependant, la faiblesse des marges de manœuvre macroéconomiques ne permet guère d’envisager une telle stratégie.
Il y a même plus : lorsque, comme c’est le cas actuellement, l’inflation est trop basse et le taux d’intérêt de court terme bloqué à zéro, toutes les réformes dont les effets transitent par une baisse des prix ont pour effet immédiat d’accroître les pressions déflationnistes et d’augmenter le taux d’intérêt réel, sans que la politique monétaire puisse y remédier. Par exemple, un renforcement de la concurrence sur des marchés oligopolistiques est normalement favorable aux consommateurs, dont le pouvoir d’achat augmente, et conduit naturellement la banque centrale à baisser le taux d’intérêt pour accompagner le choc désinflationniste, ce qui stimule la demande. Une telle mesure a donc des effets de court terme positifs. Mais lorsque l’inflation est trop faible et que le taux d’intérêt est déjà nul, les effets récessifs de court terme sont accrus et peuvent au contraire l’emporter sur les effets expansionnistes[2]. Il faut prendre ce risque en compte, surtout à un moment où la probabilité d’une déflation en zone euro est déjà estimée à 30% par le FMI.
De manière plus générale, conduire des réformes qui augmentent l’offre agrégée ou renforcent son élasticité alors que la croissance est bridée par le niveau de demande n’est pas forcément la meilleure des solutions. Dans un article récent, Gauti Eggertsson et Paul Krugman défendent même l’idée selon laquelle dans les pays de la zone euro où l’endettement des secteurs public et privé est déjà important, des améliorations structurelles qui feraient baisser le niveau des prix et donc augmenteraient le fardeau de la dette pourraient avoir pour effet de réduire encore la demande agrégée[3].
Ces réserves sont importantes. Elles suggèrent que dans le contexte actuel, le lien causal souvent postulé entre amélioration structurelle et dynamisme conjoncturel est loin d’aller de soi. Mais il ne faut pas en tirer de conclusions exagérées. Pour commencer, certaines réformes sont à peu près dépourvues d’effets négatifs à court terme et peuvent même avoir un impact positif. Encourager les créations d’entreprises en simplifiant les procédures administratives ne peut guère nuire. Autoriser l’ouverture dominicale des magasins n’exercerait pas de pression déflationniste (au contraire, cela peut conduire à une augmentation des prix en contrepartie de l’extension du service). Faciliter l’accès au crédit pour les entreprises soutient l’investissement et donc la demande. Repousser l’âge de départ à la retraite augmente le revenu permanent anticipé par les actifs et donc leur consommation instantanée, du moins dans la mesure où ils escomptent pouvoir travailler assez longtemps. Cette liste est loin d’être limitative. Il est aussi faux d’affirmer que toutes les réformes structurelles commencent par coûter avant de rapporter que de prétendre qu’elles n’ont aucun effet négatif à court terme.
Dans une récente intervention, Benoit Coeuré, membre du directoire de la BCE, met l’accent sur deux autres dimensions de la question[4]. Après la crise de la zone euro, dit-il d’abord, beaucoup de réformes ont visé la restauration de la compétitivité des pays en difficulté. Nécessaires dans un premier temps, les ajustements de prix relatifs qu’induisent de telles politiques sont aujourd’hui moins prioritaires que l’amélioration du potentiel de croissance de chaque économie. A une approche compétitive de la réforme doit donc succéder une approche plus coopérative, de nature à améliorer les perspectives pour l’ensemble de la zone et donc les anticipations de revenu permanent.
Même s’il est optimiste d’estimer que la phase d’ajustement compétitif au sein de la zone euro n’est pas complètement derrière nous, il est certainement vrai que le dosage des efforts entre compétition et coopération est appelé à se modifier en faveur de la seconde[5].
Deuxièmement, dit Coeuré, les responsables politiques doivent concevoir des stratégies de réforme en sorte de maximiser leurs effets positifs et de minimiser leurs effets négatifs. Outre un bon dosage des mesures, cela suppose selon lui une action concentrée dans le temps plutôt qu’étalée. La mise en œuvre d’un seul coup d’un paquet de réformes a en effet pour conséquence de renforcer leur crédibilité, ce qui conduit les agents économiques à mieux prendre en compte leurs incidences de long terme dans leurs propres plans de dépense. Elle permet aussi d’éviter l’étalement des effets déflationnistes, qui ne peut que nourrir des anticipations de déflation et maintenir les taux d’intérêt réels à un niveau élevé.
Aussi bien conçues qu’elles soient, cependant, les stratégies de réforme ne suffiront cependant pas à ranimer à brève échéance une économie atone. C’est là qu’intervient le deuxième volet de l’action à conduire, celui qui a trait à l’investissement.
La croissance par l’investissement ?
Depuis 2008, l’investissement productif a subi un ajustement sévère en Europe : en 2013, il se situait plus de 15% en-dessous de l’étiage de 2007, alors qu’aux Etats-Unis ce niveau avait été rattrapé[6]. Préoccupant pour la modernisation du stock de capital et la productivité, ce retard est aussi un des facteurs de la faiblesse de la demande. Relancer l’investissement permet d’agir en même temps l’offre et la demande, et c’est certainement pour cela que Jean-Claude Juncker a choisi de le mettre en avant dans son discours-programme. Cependant, la mise en place d’un plan d’investissement n’est pas chose aisée. Pourquoi les entreprises investiraient elles alors qu’il y a déjà un excès d’offre ? Faut-il, d’ailleurs, accroître l’investissement en période d’excès d’offre ? Et s’il s’agit d’investissements publics, où les gouvernements trouveront-ils les ressources nécessaires ?
C’est à ces questions que se confrontent ceux qui s’attachent aujourd’hui à décliner les perspectives tracées par Jean-Claude Juncker en orientations opérationnelles. L’expérience invite à la prudence. Ce n’est en effet pas la première fois que l’Union s’engage dans un programme d’investissements. En 1993, sous l’impulsion de Jacques Delors, en 2000, avec l’agenda de Lisbonne qui prévoyait de porter l’investissement en recherche et développement à 3% du PIB, et plus près de nous en 2012, avec le paquet croissance de 120 milliards approuvé par les chefs d’État et de gouvernements, de telles initiatives ont déjà été prises. Aucune n’a abouti.
En matière d’investissement public, la décision appartient en principe aux responsables politiques. Il ne faut toutefois pas surestimer leur capacité d’action. Outre la situation des finances publiques, qui constitue une contrainte sévère dans un certain nombre de pays, le développement des infrastructures se heurte aussi à des problèmes d’incitation et de coopération entre collectivités publiques, et souvent à l’opposition des citoyens directement affectés par les nouveaux équipements. En Allemagne par exemple, complexité du fédéralisme et réticences citoyennes limitent fortement l’investissement public. La situation appelle sans doute un engagement fort des responsables et un dépassement des contraintes traditionnelles. Mais le réalisme oblige à dire que l’investissement public, qu’il soit local, national ou européen, n’est pas la panacée que l’on espère parfois.
Les responsables publics disposent cependant d’autres moyens d’action que l’exhortation ou l’engagement de leurs propres ressources. Supposons qu’un gouvernement ait le pouvoir de forcer les entreprises à se débarrasser de leurs équipements de production les plus anciens afin de les remplacer par des machines neuves ayant un meilleur rendement. Cela déclencherait une vague de nouveaux investissements et stimulerait à la fois la demande de court terme et la productivité de moyen terme, sans accroissement quantitatif de l’offre et donc sans accentuation du déséquilibre entre production potentielle et demande.
Or il se trouve que les gouvernements possèdent bel et bien un tel pouvoir. Ils peuvent en effet utiliser l’outil réglementaire pour inciter les acteurs économiques à remplacer leurs équipements. C’est, par exemple, ce qu’ils ont fait avec les normes d’émission des véhicules automobiles en circulation. Cela pousse les détenteurs de véhicules anciens à les remplacer par des modèles plus modernes et plus respectueux de l’environnement. Ils peuvent aussi jouer sur la fiscalité pour modifier le rendement relatif des équipements existants et des équipements nouveaux. C’est par exemple ce que produisent des dispositions permettant l’amortissement accéléré ou ce qui est fait en matière d’habitat avec les incitations fiscales aux économies d’énergie.
Il serait possible d’avoir la même action, mais à plus grande échelle, en fixant de manière crédible une fourchette d’évolution pour le prix du carbone d’ici 2030 (et par là donner effectivité à l’accord européen sur le climat intervenu en octobre 2014). Cela inciterait les détenteurs d’équipements peu efficaces à les remplacer et pousserait les entreprises à investir dans des technologies et des dispositifs économes en émissions de carbone. Bonne pour le long terme – car il est illusoire de supposer que l’Europe ou la France atteindront leurs objectifs de réduction des émissions si la fiscalité ne fournit pas aux agents économiques les signaux prix adéquats – une telle mesure serait aussi efficace à court terme pour inciter à l’investissement. De la même manière, la mise en place de critères d’efficacité environnementale plus restrictifs sur l’usage du diesel ou d’incitations fiscales stables sur l’isolation des logements serait de nature à stimuler les investissements.
Une telle démarche requiert évidemment quelques précautions. Elle suppose d’abord que les autorités publiques soient crédibles et que leurs engagements sur la durée soient pris au sérieux. Ni l’Union européenne, ni l’État français n’ont aujourd’hui une forte crédibilité, la première parce qu’elle s’est trop souvent bornée à afficher des objectifs sans se préoccuper des moyens de les atteindre, le second parce qu’il a fait, au fil des années, preuve d’une remarquable inconstance, dont la dernière manifestation a été l’abandon de l’écotaxe. Soumis à la nécessité de répondre aux attentes immédiates, les responsables politiques ne mesurent pas toujours à quel point l’incertitude sur le cours de l’action publique suscite l’attentisme des acteurs économiques et, en particulier, freine la réalisation d’investissements privés à longue portée.
Il s’agit ensuite de cibler en priorité les domaines où l’incitation peut contribuer à accélérer le remplacement d’équipements en voie d’obsolescence. Une stratégie visant au remplacement du capital serait excessivement coûteuse si elle conduisait à mettre au rebut des équipements récents et performants. Elle n’a par ailleurs de sens que si les technologies de remplacement ont atteint un stade de maturité suffisant. Il ne faut pas répéter l’expérience des panneaux solaires, dont l’installation massive, suscitée par des tarifs d’achat trop avantageux, s’est avéré très coûteuse. Plutôt que de financer à grands frais la mise en œuvre d’une technologie encore en développement, il aurait été préférable de rechercher un équilibre entre soutien au déploiement et subvention à la recherche.
Plus largement, l’Union européenne a une responsabilité particulière en matière réglementaire. Dans plusieurs secteurs régulés, la superposition de dispositions réglementaires nationales et européennes freine les investissements, notamment trans-frontières. Cette situation est dommageable.
Enfin, déprécier un capital productif en place a nécessairement un impact direct sur le profit des entreprises. Les grandes entreprises, dont les profits sont substantiels, auraient sans doute la capacité de résister à un tel choc, mais ce ne serait pas forcément le cas pour les PME et les entreprises de taille moyenne, qui sont économiquement plus vulnérables. L’instrument doit donc être manié avec précaution. L’idéal serait d’assurer sur le moyen terme une bonne visibilité des paramètres de la décision d’investir tout en limitant les effets de choc à court terme. Encore une fois, cependant, un séquençage de ce type suppose une crédibilité qui fait souvent défaut.
En matière d’investissement, un troisième levier est d'ordre financier. En Europe continentale le financement des investissements est traditionnellement fondé sur le crédit bancaire, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis où les marchés financiers règnent en maîtres. Mais depuis la crise financière, il est demandé aux banques de réduire leur endettement et de s’assurer de disposer d’un capital à la mesure des risques qu’elles prennent sur leur bilan. Leurs créanciers ont de plus été informés de ce qu'ils ne doivent pas s'attendre à être renfloués par l’État en cas de difficulté.
Cette prudence est intentionnelle. Les gouvernements et les citoyens européens ont payé - et continuent à payer - un prix astronomique pour les folies financières des années 2000. Ils ne veulent pas répéter l'expérience. La conséquence, toutefois, est que les projets à haut rendement potentiel mais économiquement ou techniquement risqués portés par les entreprises de taille moyenne sont plus difficiles à financer qu'ils ne devraient être. Si l'Europe veut relancer son économie, elle a besoin que ses entrepreneurs innovent. Mais son système financier est en transition et dans les conditions actuelles, on ne peut à la fois demander aux banques de ne pas prendre trop de risques et de s’engager dans le financement de projets au rendement nécessairement aléatoire.
C’est pourquoi le côté public - à la fois les gouvernements nationaux et l'UE - doit aujourd’hui intervenir et partager une partie du risque avec les acteurs privés. Temporairement, dans cette phase où le système financier est en mutation, la puissance publique doit se comporter davantage comme un investisseur qui scrute les projets et participe à leur financement. Utiliser à cette fin les banques de développement comme BPI France et la Banque Européenne d’Investissement – avec ce que cela suppose de prise de risque sur les budgets des États ou celui de l’UE - aiderait à surmonter l'impasse actuelle.
Conclusion
Au total, ces différentes réflexions suggèrent d’abord que l’environnement macroéconomique des politiques de réforme ne peut pas être ignoré. Dans un contexte qui présente de sérieux risques macroéconomiques, les décideurs peuvent moins que jamais se borner à sélectionner leurs priorités en fonction de la faisabilité supposée des différentes mesures et à les ordonner dans le temps en fonction de considérations d’opportunité politique. Ce serait prendre le risque de prendre des mesures sans doute positives pour le long terme, mais coûteuses à l’excès dans le court terme. Il faut, plutôt concevoir des stratégies de réforme qui, à la fois par le choix des mesures et le séquençage des actions, offrent les meilleures chances de combiner redressement de la croissance potentielle et prévention des risques récessifs immédiats. L’analyse suggère que c’est possible.
Les réformes à elles seules ne suffiront cependant pas et c’est pourquoi il importe de les accompagner par une initiative européenne sur l’investissement. Pour que celle-ci ait quelque chance de produire un résultat visible, il importe d’être au clair sur les leviers mobilisables. Trois paraissent important. Il s’agit tout d’abord de l’investissement public, particulièrement dans les pays qui disposent de marges de manœuvre. L’action réglementaire et fiscale peut ensuite être mise à contribution ; un usage stratégique de la réglementation et de la fiscalité devrait permettre d’accélérer l’investissement privé dans des équipements nouveaux, en particulier dans les domaines comme l’énergie et l’efficacité environnementale ; plus généralement, la clarté et la prévisibilité du cadre réglementaire peuvent grandement contribuer à la reprise des investissements privés. L’action sur le financement constitue enfin le troisième volet : alors que le système financier est en transition d’un système fondé sur le crédit bancaire et l’effet de levier à un système qui reposera davantage sur les financements de marché, l’action publique doit pallier une difficulté temporairement accrue du système financier à accompagner les investissements productifs risqués ; cela suppose la mise en œuvre de techniques de partage du risque entre sphère publique et sphère privée.
Article publié dans Problèmes économiques, numéro spécial JECO, novembre 2014
______________________________________________________
[1] Voir Jean-Claude Juncker, « Un nouvel élan pour l’Europe : Mon programme pour l’emploi, la croissance, l’équité et le changement démocratique », Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne, juillet 2014.
[2] Pour une formalisation de l’argument voir Gauti Eggertsson, Andrea Ferrero et Andrea Raffo, “Can structural reforms help Europe?”, Journal of Monetary Economics, vol. 61(C), pp. 2-22, 2014.
[3] Voir Gauti Eggertsson et Paul Krugman, “Debt, Deleveraging, and the Liquidity Trap: A Fisher-Minsky-Koo Approach”, The Quarterly Journal of Economics 127 (3), pp. 1469-1513, 2012.
[4] Benoît Coeuré, “Structural reforms: learning the right lessons from the crisis”, keynote speech, Economic conference, Latvijas Banka, Riga, 17 October 2014, disponible sur le site de la BCE.
[5] Pour une analyse sceptique des résultats de l’ajustement en zone euro, voir Kevin Stahler et Arvind Subramanian, «Versailles redux : Eurozone competitiveness in a dynamic Balassa-Samuelson-Penn framework, mimeo, octobre.
[6] Voir Fabien Dell, Pierre Douillard, Lionel Janin et Nicolas Lorach, « Y a-t-il un retard d’investissement en France et en Europe depuis 2007 ? », Note d’analyse France Stratégie, septembre 2014.