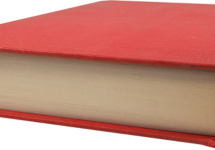Si l’on en croit la récente interview accordée à Jeffrey Goldberg pour le magazine The Atlantic, Obama est « très fier » de ce moment où il a réfléchi et soupesé les options, pour finalement prendre le contrepied de ses conseillers et décider de ne pas suivre les « règles du jeu de Washington ». Tout le monde n’a pas applaudi. Selon Goldberg, Hillary Clinton, qui avait quitté quelques mois plus tôt son poste de secrétaire d’État, a critiqué en privé la décision : « Lorsqu’on dit qu’on va frapper, il faut frapper. » Mais Obama a refusé de se laisser obnubiler par la question de la crédibilité : « Larguer des bombes sur quelqu’un pour prouver que vous êtes prêt à larguer des bombes sur quelqu’un – dit-il –, c’est la plus mauvaise raison qui soit pour faire usage de la force. »
La position d’Obama s’inscrit dans la continuité de son désormais célèbre leitmotiv : « Pas de conneries ! » (« Don’t do stupid shit! ») L’expression est une allusion transparente à la décision mal avisée prise par son prédécesseur d’intervenir en Irak ; mais, plus fondamentalement, elle résume la façon dont Obama apprécie les risques inhérents à tout choix politique importante. À l’évidence, il ne considère pas que sa crédibilité soit une exigence assez important pour accepter de se lier les mains. Pour lui, c’est la pertinence de la décision qui, en dernier ressort, l’emporte sur la cohérence avec les déclarations précédentes. Il est plus important de rester libre de prendre les meilleurs moyens pour résoudre un problème que d’envoyer le message qui convient sur la manière dont on répondra aux crises futures.
La politique de sécurité et la politique économique ont ceci de commun, qu’elles contraignent les gouvernements à choisir entre préserver leur crédibilité et agir pour limiter les dégâts immédiats. Les controverses économiques opposent elles aussi fréquemment les tenants de la liberté de jugement et ceux de la continuité, pour lesquels la cohérence est l’étalon-or de toute bonne politique.
Tels étaient par exemple les termes de l’arbitrage à l’été 2008, alors que la crise financière mondiale atteignait son point culminant. Après que le gouvernement américain avait décidé de renflouer la banque d’investissement Bear Stearns et de soutenir les agences hypothécaires Fannie Mae et Freddy Mac, les protestations du Congrès conduisirent l’administration du président George W. Bush à promettre qu’elle n’injecterait plus d’argent public dans les établissements en difficulté, en l’occurrence la banque d’investissement Lehman Brothers. Lorsqu’il apparut qu’aucun investisseur privé n’était disposé à reprendre Lehman, le Trésor américain, à court de ressources, ne disposait pas des moyens légaux nécessaires pour prévenir le désastre. Et le désastre survint, le 15 septembre.
Des arbitrages du même ordre durent être régulièrement rendus au cours de la crise de l’euro. Pratiquement tous les épisodes importants se soldèrent par un choix entre le strict respect des principes et l’exploration de solutions aptes à parer les dangers d’une crise qui se propageait rapidement. Mais le leitmotiv de la chancelière Angela Merkel n’était pas vraiment celui d’Obama. À ses yeux, des mesures non conventionnelles ne pouvaient se justifier qu’en cas de menace existentielle imminente pour la stabilité de la zone euro. Cette doctrine du dernier recours, de l’ultima ratio, fut régulièrement invoquée pour différer les décisions ou rejeter les remèdes d’urgence, avec pour conséquence qu’on a laissé les crises se propager au lieu d’agir vite pour les contenir.
Le dilemme entre résoudre un problème annoncé ou refuser d’encourager l’aléa moral est profond. Il est omniprésent dans la sphère financière et fréquemment sous-jacent aux décisions monétaires ou budgétaires. Deux écoles de pensée coexistent. La première, qui est généralement celle de l’administration américaine (mais pas nécessairement celle du Congrès), considère que si l’aléa moral pose un vrai problème, il ne doit pas pour autant être surévalué : « Les pompiers ne sont pas la cause du feu », comme le disait l’ancien secrétaire américain du Trésor, Tim Geithner (ou encore, selon le numéro 2 de la Réserve fédérale, Stan Fischer, « les préservatifs ne sont pas responsables des relations sexuelles »). L’Allemagne est le plus notable représentant de l’école opposée : pour ses dirigeants, ce sont généralement les conséquences à long terme d’une décision qui doivent servir de guides aux choix politiques, et il ne faut pas que la perspective d’être assuré contre les risques incite à l’imprudence.
Il ne faut pas s’étonner de ces désaccords. L’arbitrage est bien réel, et les responsables politiques peuvent avoir des points de vue divergents, selon leur expérience et leurs préférences temporelles. L’école allemande est attachée à la permanence des règles du jeu et tend à minorer les conséquences immédiates des décisions, pour mettre l’accent sur leurs effets à long terme. Une autre raison des différences, peut-être plus profonde, tient à l’exercice de la puissance. Depuis plusieurs décennies, le gouvernement des États-Unis joue le rôle de pompier en dernier ressort du système global. Pendant tout ce temps, il a dû gérer une multitude de crises, dans le monde entier, et a appris à accorder plus d’importance à la liberté d’appréciation qu’à la continuité ou à la constance politique.
Comment, donc, éviter de faire des erreurs en matière de politique économique ? Ce qui compte le plus, sans doute, est la transparence du processus de décision et de ses conséquences. S’affranchir de la rigidité des règles ne doit pas conduire à l’arbitraire. Un échange d’arguments vigoureux et critique et – surtout lorsque l’urgence ne laisse pas de temps pour une discussion préalable – la conscience claire que toute décision devra par la suite être expliquée et justifiée sont d’excellents antidotes à l’abus de pouvoirs discrétionnaires. Le débat et l’obligation de rendre des comptes peuvent largement contribuer à éliminer les mauvaises idées.
Sans doute ces raisonnements sont-ils plus faciles à appliquer dans la conduite de la politique économique que sur le champ de bataille. Mais les décisions économiques et financières peuvent elles aussi avoir besoin de secret et de diligence. Pour s’assurer contre les risques de l’arbitraire, les institutions concernées n’ont pas de raison de ne pas se doter des procédures internes appropriées, ou de prévoir que toute décision sera par la suite examinée avec l’attention requise. Sur ce point, il y a encore beaucoup de progrès à faire.