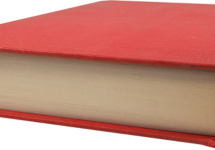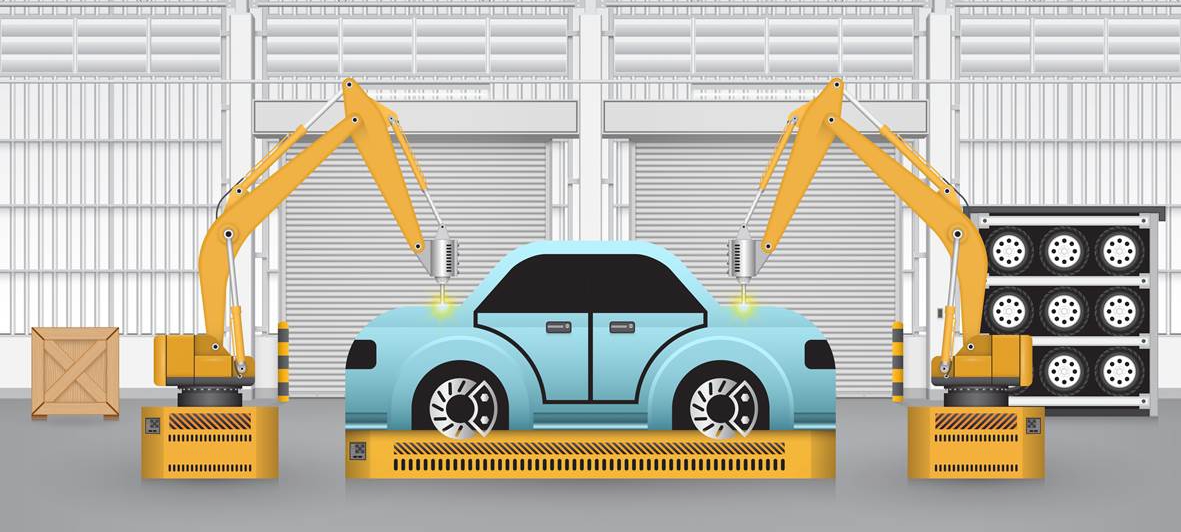
200 millions de personnes dans le monde sont actuellement au chômage, 30 millions de plus qu’en 2008. C’est dans ce contexte qu’émerge à nouveau une grande peur, celle de voir l’homme remplacé par des machines. Les robots n’ont pas envahi nos vies, mais ils occupent nos esprits. Et une prédiction revient au goût du jour : celle du prix Nobel Wassily Leontief qui, en 1983, annonçait pour le travail humain le sort qu’a connu celui des chevaux au début du XXème siècle.
La plupart des économistes restent dubitatifs face à de telles alarmes. Pour deux raisons. Premièrement, ils ont déjà entendu cette prédiction plusieurs fois, et ont appris qu’une augmentation globale de la productivité détruit rarement des emplois. A chaque fois que les machines ont gagné en efficacité (y compris quand des véhicules à moteur et des tracteurs ont remplacé les chevaux), de vieux métiers ont disparu, mais de nouveaux les ont remplacés. Deuxièmement, les économistes adorent les chiffres, et ce qu’ils y voient actuellement, c’est plutôt un ralentissement de la productivité qu’une accélération.
Mais à considérer les choses sous cet angle, on risque de passer à côté du vrai sujet. Quelle que soit la quantité de travail utilisée au cours des décennies à venir, il ne fait pas de doute que sa nature va être profondément transformée.
Deux tendances sont à l’œuvre. La première tient bien sûr à l’arrivée des robots et aux changements qu’ils imposent au travail humain. Comme l’a relevé l’économiste David Autor (MIT), les machines ne se remplacent pas seulement les travaux répétitifs, comme le traitement de données. Elles rendent aussi plus productif le travail abstrait ou créatif. Et elles n’améliorent qu’à la marge la productivité de la troisième catégorie de travailleurs, ceux qui fournissent des services à la personne. Si les robots rendent les comptables inutiles, ils dopent la productivité des chirurgiens et ne changent rien à celle des coiffeurs. Les conséquences de cette transformation sont au moins aussi importantes que l’évolution de la quantité globale de travail.
En résulte une polarisation du marché du travail, avec davantage d’emplois en bas de l’échelle salariale –notamment dans les services à la personne-, et davantage d’emplois dits « créatifs » en haut de l’échelle, mais entre les deux une réduction du nombre d’emplois de qualification intermédiaire. Le mouvement a commencé il y a 20 ans environ aux États-Unis et touche désormais l’Europe.
Cette évolution impacte l’économie, mais aussi toute la société. Après 1945, la classe moyenne est devenue comme un idéal pour les pays avancés. Les catégories à bas revenu espéraient y accéder, et les riches estimaient ou prétendaient en faire partie. L’idée était que tout le monde pouvait en être, à condition de travailler durement. Cette classe moyenne a imposé son mode de vie, ses structures de consommation. Elle a fourni le socle de la démocratie. Sa disparition perturberait le fonctionnement de la société entière et diminuerait fortement le rôle du travail dans la formation de l’identité sociale. Avec, à la clef, un retour de la lutte des classes.
Deuxième tendance : « l’uberisation ». Uber a créé un nouveau modèle de travail, où les individus apporteurs de services accèdent aux clients via une plateforme numérique. Quand un client appelle une voiture Uber, il ne lui achète pas un service mais deux : l’un (l’accès au chauffeur et le contrôle de qualité associé) est fourni par Uber, tandis que l’autre, le transport, est fourni par le chauffeur lui-même. A la différence des géants de l’économie d’antan, Uber ne compte pas des dizaine ou des centaines de milliers d’employés, mais il organise cependant leur travail.
C’est une véritable révolution, parce que Uber et les autres plateformes digitales redéfinissent le travail, envoyant au rebut le modèle de la firme de l’âge industriel. Le rôle de la firme dans l’économie du XXème siècle était essentiel, en ce qu’elle organisait les relations entre les travailleurs beaucoup mieux que ne pouvait le faire le simple marché. Elle permettait la spécialisation et une économie substantielle de coûts de transaction. C’est en est fini avec Uber. Plus besoin de contrat de travail. Au lieu de passer par l’autorité d’un chef d’entreprise, le travail individuel est intermédié par l’informatique.
Il faut insister sur les lourdes conséquences de cette transformation. Le travail devient l’objet d’un échange sur le marché et fait tout comme une matière première l’objet d’une cotation en continu : le contrat de travail est remplacé par la vente d’un service dont la quantité et le prix varient en temps réel, au gré de l’offre et de la demande.
Est-ce de la fraude ? Peut-être, en regard de notre législation. Mais ne nous faisons pas d’illusion : notre vieux système ne résistera pas longtemps aux avancées technologiques. Plutôt que de dresser des digues, ou en tous cas en même temps que nous les dressons, réfléchissons donc aux conséquences de ce nouveau modèle qui met en péril le soubassement salarial de nos institutions sociales.
De véritables ruptures sont donc à attendre. Ajoutons-y que les jeunes diplômés délaissent aujourd’hui les grands groupes pour se faire embaucher par une start up, quitte à gagner moins dans un premier temps, escomptant à terme un revenu supérieur. On voit poindre des stratégies de maximisation du revenu sur tout le cycle de la vie professionnelle, destinées à tirer le maximum de profit d’un capital humain. Ce type de comportement mine lui aussi la place centrale du contrat salarial.
Comment les sociétés peuvent-elles répondre à cette révolution ? Certaines sont, à l’instar des chauffeurs de taxis, tentées de résister au changement. D’autres se résignent à l’adaptation à un monde qu’elles ne déterminent pas. Certaines enfin cherchent à la fois à miser sur le changement et à inventer un nouveau modèle social : c’est, bien sûr, la stratégie la plus féconde. Parce que ce n’est ni aux robots ni aux plateformes, mais aux citoyens qu’il appartient de construire les institutions sociales de demain.
(c) Project Syndicate