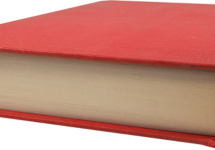France Stratégie publie des analyses de fond, et des études de prospective à moyen et long termes pour contribuer à la décision publique et à l’information de l’opinion. Tous les agents de France Stratégie et la plupart de leurs interlocuteurs demeurent actuellement en télétravail, ce qui nous permet d’assurer la continuité de nos missions dans le respect des mesures de déconfinement progressif et de distanciation physique. Nous sommes ainsi en mesure d’achever et de publier les travaux engagés avant la crise sanitaire et de mener à bien de nouveaux travaux qui tiennent compte de la crise elle-même et de ses conséquences.
Télécharger le point de vue – La planification : idée d’hier ou piste pour demain ?
Certaines difficultés rencontrées dans la gestion de la crise sanitaire, notamment en matière d’approvisionnement, et les questionnements sur la relance ou la réorientation de l’activité économique après l’épidémie ont fait réapparaître la notion de planification dans le débat public français[1]. Le président de la République lui-même, dans son allocution du 13 avril, lorsqu’il évoquait la nécessité de « rebâtir notre économie plus forte [et de] rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique », précisait que, selon lui, cela supposait « une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété carbone, la résilience qui seuls peuvent nous permettre de faire face aux crises à venir[2] ».
De quoi parle-t-on au juste lorsqu’on évoque ce type d’intervention publique dans l’activité économique qu’est la « planification » ? Et quelles sont les insuffisances du fonctionnement actuel que l’on cherche alors à souligner et à surmonter ? Il n’est pas inutile, pour éclairer ces questions, de remonter à ce que fut, en France, la planification et en particulier son organe principal, le Commissariat général du Plan, créé en 1946 par le général de Gaulle avec à sa tête Jean Monnet, transformé en 2006 en Centre d’analyse stratégique et dont France Stratégie est depuis 2013 le descendant[3]. L’idée n’est pas ici de cultiver la nostalgie d’une telle institution mais de comprendre, par la comparaison entre deux contextes profondément différents, ce que « planifier » pourrait vouloir dire aujourd’hui, en France.
Le Plan, c’était quoi ?
La création, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, du Commissariat général du Plan résulte de la rencontre de plusieurs courants de pensée : notamment de ceux qui, au cours des années 1930 (dans différents partis politiques, en Europe comme outre-Atlantique) ont théorisé de nouvelles modalités d’intervention de l’État dans le domaine économique pour faire face aux insuffisances du marché, pour réduire les risques de crise et de ceux qui, pendant le conflit lui-même, ont œuvré à la coordination de la production nécessaire à « l’effort de guerre », en particulier anglais et américain.
Une idée venue d’ailleurs…
Les derniers travaux de l’historien Patrick Weil suggèrent que c’est dès la Première Guerre mondiale que Jean Monnet forge la matrice[4] de ce qui deviendra plus tard le « Plan ». Walther Rathenau, à la tête de l’entreprise AEG, propose alors en Allemagne, pour faire face au blocus, une gestion rationalisée des stocks et des ressources, associant les entreprises et le gouvernement. Du côté des Alliés, on organise également des « Boards » avec le même type d’objectifs ; et ces modèles sont de nouveau mobilisés au cours de la Seconde Guerre mondiale… avec encore le concours de Monnet. D’après Marie-Laure Djelic, c’est bien l’implication de Jean Monnet dans le « War Production Board » et le « Combined Production and Resources Board » américains qui est l’inspiration la plus directe des premiers travaux du CGP[5]. Ces travaux visent précisément la mise en cohérence des différents secteurs de production et la meilleure allocation des ressources disponibles dans le contexte contraint de la guerre. Et dans la mesure où le Premier Plan, adopté en 1946, ambitionne lui aussi de répartir des ressources et d’éviter les pénuries, dans un moment où les besoins augmentent vite, on peut considérer qu’il s’inspire des méthodes éprouvées dans l’économie de guerre elle-même.
Cependant, ce plan est d’emblée appelé « de modernisation et d’équipement[6] » et vise ainsi un double objectif : à la fois reconstruire le pays et le moderniser. Autrement dit, il ne s’agit pas d’organiser la production pour restaurer au plus vite et à l’identique l’économie d’avant-guerre mais d’opérer simultanément la définition de priorités liées à l’urgence (dans l’usage des matières premières notamment) et le développement, avec un horizon de plus long terme, d’un appareil économique national répondant à de nouveaux standards (en l’occurrence, principalement en matière de productivité et d’industrialisation).
Malgré le terme de « plan », on est alors bien loin du « Gosplan » à la soviétique, à la fois dans la méthode et dans les finalités. L’inspiration est à dominante américaine et à coloration keynésienne, du fait du prestige dont est alors auréolé le New Deal de Roosevelt et de la puissance du Plan Marshall, qui a largement contribué à financer les réalisations du Plan Monnet.
Hiérarchiser les investissements, optimiser l’usage des ressources
Concrètement, que faisait-on « au Plan » ? Placé auprès du président du Conseil, le commissaire général du Plan animait notamment les travaux de plusieurs « commissions de modernisation », consacrées aux différentes ressources (houillères, électricité, carburants, main-d’œuvre, etc.) et aux différents secteurs d’activité (construction, automobile, textile, etc.), et réunissant divers acteurs (patronaux, syndicaux, administratifs) et des experts ou des « personnalités qualifiées ». Jean Monnet s’enorgueillit ainsi que « plus de mille Français de toutes origines » ont participé à ce travail collectif qu’est le premier Plan.
À une époque où, après les nationalisations décidées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans de nombreux secteurs d’activité essentiels (énergie, transports, aciéries, banques), près de 50 % des investissements industriels passent directement par les caisses de l’État, la puissance publique dispose avec le nouveau commissariat d’un levier puissant pour orienter et coordonner la production nationale et pour optimiser l’usage des ressources, l’appareil productif étant encore loin d’être reconstitué à ses niveaux antérieurs. Il s’agit alors de définir des objectifs sur un horizon de plusieurs années et de prévoir les différentes étapes pour y parvenir, en coordonnant les différents secteurs qui y concourent.
Cela passe donc par une hiérarchisation des secteurs prioritaires et des investissements nécessaires pour les développer, afin de doter l’économie nationale des infrastructures qui auront le plus puissant effet de levier sur l’ensemble des activités jugées utiles. C’est ainsi que l’un des grands chantiers du premier fonds de modernisation et d’équipement concerne, en 1947, le financement d’un train de laminage à large bande, pour Usinor, à Florange – le rétablissement puis le développement de la sidérurgie étant une condition au déploiement de nombreuses autres activités industrielles.
Dans l’ensemble, les objectifs fixés par les premiers plans sont atteints voire dépassés. Dans le rapport qu’il remet en 1994 au Premier ministre Édouard Balladur sur « L’avenir du Plan et la place de la planification dans la société française[7] », le député Jean de Gaulle rappelle que les objectifs sectoriels du Plan Monnet ont presque tous été atteints, que ceux du deuxième plan ont été dépassés, en dépit des conflits de décolonisation surgis dans cette période (1952-1957), et que la Guerre d’Algérie n’a pas empêché le troisième plan d’atteindre son objectif de « retour à l’équilibre » de l’économie française.
Objectiver, dialoguer, orienter
Il ne faudrait pas cependant se représenter les « plans » de cette époque comme des directives édictées dans des administrations centralisées et imposées verticalement à tous les acteurs du pays. La première étape de la planification repose en effet sur la concertation, associant notamment les partenaires sociaux, afin de définir un horizon commun, à la fois désirable et accessible.
D’emblée, le Plan vise à l’élaboration de diagnostics partagés, via la confrontation des travaux des services d’expertise économique, notamment de l’Insee et du SEEF (Service des études économiques et financières[8]), avec les points de vue des acteurs sociaux.
La participation des « forces vives de la Nation » à l’élaboration du plan est vue, dès Jean Monnet, comme une condition de sa réussite : « On ne pourra pas transformer l’économie française, disait-il à de Gaulle fin 1945, sans que le peuple français participe à cette transformation. Quand je dis “le peuple”, ce n’est pas une entité abstraite, ce sont les syndicats, les industriels, l’administration, tous les hommes qui seront associés à un plan d’équipement et de modernisation[9] ». Pierre Mendès-France, quelques années plus tard, résumait cette idée en disant que « le Plan doit être fait par le pays lui-même ». On parlerait presque, aujourd’hui, de « projet de société ».
Il semble donc impossible de séparer radicalement le plan comme méthode et la planification comme orientation de politique économique. On évoquait alors, plutôt qu’une économie dirigée, une « économie concertée[10] », définissant ainsi la voie médiane revendiquée par la France gaulliste entre libéralisme et communisme. Ni norme contraignante, ni pure spéculation, « les objectifs à déterminer par le Plan […] revêtent pour tous les Français un caractère d’ardente obligation », selon les termes choisis par de Gaulle, alors président de la République, en 1961.
Cela résume le sens profondément politique que prend pour lui cet instrument : « Il embrasse l’ensemble, fixe les objectifs, établit une hiérarchie des urgences et des importances, introduit parmi les responsables et même dans l’esprit public le sens de ce qui est global, ordonné et continu, compense l’inconvénient de la liberté sans en perdre l’avantage », écrit-il dans ses Mémoires d’espoir.
Des perspectives qui s’élargissent
Au cours du temps, et à mesure que les promesses d’expansion industrielle se réalisent, les réflexions produites par le Commissariat du Plan élargissent leur horizon. Dès le début des années 1960, les quatrième et cinquième plans deviennent des plans « de développement économique et social » et non plus seulement d’« équipement et de modernisation ».
Dès l’introduction du quatrième plan (1962), on lit des interrogations sur le sens même de la démarche de planification, dans un monde « aux frontières ouvertes », dans un pays où « l’initiative privée et l’action publique coexistent »[11]. Pour y répondre, le Plan invite à articuler les objectifs collectifs (« survie, progrès, solidarité, rayonnement ») et les objectifs individuels (« réduction de la durée, de la pénibilité et des risques du travail, accroissement de la consommation, développement des services publics ») et plaide pour les « équipements collectifs » aux dépens de la « société de consommation » et au service d’une « idée moins partielle de l’homme[12] ».
Et le cinquième Plan, en 1966, s’éloigne de la caricature qu’on pouvait faire de cette institution historiquement tournée vers l’industrie et la croissance, en promouvant, toujours au nom de cette vue « moins partielle » de l’homme, chère au commissaire Pierre Massé, un « progrès économique durable et sain », comprenant une politique des revenus et des objectifs élevés en matière de conditions de vie, et associant le Conseil économique et social à son élaboration[13]. C’est notamment sous l’impulsion de Jacques Delors, chef du service des affaires sociales de 1962 à 1969, que le Plan s’est efforcé d’intégrer dans ses travaux les mesures de la « qualité » de la vie, et non pas seulement les quantités produites, pour qu’elles puissent avoir le même poids, la même réalité, la même lisibilité dans les débats que les aspects strictement économiques.
Dans le dernier quart du XXe siècle, le rôle du Plan dans l’économie nationale s’est considérablement réduit, à mesure que la France faisait le choix de l’intégration européenne, de l’insertion dans la mondialisation marchande et de la libéralisation de son économie. Néanmoins, dans un monde plus incertain qu’auparavant, la puissance publique n’a pas renoncé à certains outils de projection à moyen terme, qui sont pour plusieurs d’entre eux directement hérités des pratiques instaurées autour du Commissariat du Plan, même s’ils ne découlent plus du type de vision synoptique qu’offrait la planification.
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
Si l’on voulait résumer ce qui caractérisait un « plan », et que l’on ne retrouve plus parmi les outils de l’action publique en France au XXIe siècle, il conviendrait de souligner la conjonction de différentes dimensions dans un seul et même exercice : la projection dans un horizon temporel d’une demi-douzaine d’années ; l’adoption d’une vision globale touchant à la totalité de l’action publique et à l’ensemble des enjeux sociaux, visant à la prise en compte de diverses externalités ; l’organisation d’une large concertation d’experts et de parties prenantes dans une perspective d’intérêt général ; le déploiement de ressources publiques importantes et coordonnées, autour de priorités définies ; la coordination étroite, dans sa mise en œuvre, de nombreux acteurs publics et privés.
Pour autant, la fin du « Plan », assortie de la disparition d’instruments comme le « circuit du Trésor », pour financer les investissements publics, comme le « contrôle des changes » ou la propriété publique de grandes entreprises, n’a pas signifié l’abandon de toute approche de moyen terme ou de toute pratique de coordination d’acteurs. Qu’il s’agisse de démarches sectorielles ou de projections centrées sur les finances publiques, il convient de les passer en revue pour comprendre en quoi elles se distinguent de ce qu’était la logique de la planification.
Programmer les finances publiques au-delà de l’annualité budgétaire
Le principe de l’annualité budgétaire limite les possibilités, pour un gouvernement, d’engager des dépenses au-delà d’une année civile, et une lecture stricte d’un tel principe empêcherait une visibilité pluriannuelle sur l’action de l’État, pourtant nécessaire pour que d’autres acteurs puissent eux-mêmes se projeter dans la durée. C’est pourquoi, même sans « lois de plan », il existe plusieurs manières pour l’État de s’engager sur une action durable.
Historiquement, tel est le sens des « lois de programmation[14] » sectorielles, même si leur dimension de programmation budgétaire n’est qu’indicative et peut être remise en cause à chaque budget annuel. Parmi les dernières adoptées en France, on trouve la loi de programmation et de réforme de la justice (en 2019), des lois de programmation militaire (en 2013 puis en 2018), la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (en 2014) ou encore la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école (en 2013). Chacun de ces textes prévoit à la fois des actions de transformation de la politique publique concernée et la mise en œuvre de moyens adaptés, sur une durée d’environ cinq ans, à cette transformation (créations d’emplois publics, investissements, etc.).
Le rôle des lois de programmation des finances publiques[15] est sensiblement différent : elles visent à crédibiliser les engagements financiers de l’État en prévoyant l’évolution des soldes publics sur une période d’au moins trois ans. Si elles n’ont pas de puissance normative plus forte que les autres lois de programmation, elles traduisent cependant, depuis l’adoption du Traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) et de la loi organique de décembre 2012[16], l’inscription des budgets nationaux dans le cadre des règles européennes.
Par contraste avec les « lois de plan », qui faisaient de l’évolution du PIB un objectif intégré à la démarche du plan, le taux de croissance est, dans les lois de programmations des finances publiques, une hypothèse (définie après avis du Haut Conseil des finances publiques) sur la base de laquelle est construite la trajectoire budgétaire. Que le principal outil transversal de programmation pluriannuelle soit désormais de nature exclusivement budgétaire peut être considéré comme un révélateur du déplacement du centre de gravité des considérations qui président à la définition de la politique économique. D’un horizon stratégique et substantiel, établissant des objectifs sectoriels en vue desquels étaient mobilisés diverses ressources (dont les finances publiques), on est ainsi passé à un horizon comptable, où le solde est défini en amont comme le cadre dans lequel les différentes actions sont inscrites – ce qui ne veut naturellement pas dire qu’en pratique la priorité politique ait systématiquement été donnée à la réduction du déficit public.
Parmi les instruments permettant à un gouvernement de se projeter au-delà du budget de l’année à venir, le Programme des investissements d’avenir (PIA), décliné en trois vagues (2010, 2013 et 2016), doit retenir l’attention dans la mesure où il est présenté par ses promoteurs comme l’outil par lequel la France doit de nouveau se montrer capable de se projeter dans l’avenir : face à « la tyrannie du court terme », il s’agit d’investir « au seul service des générations futures » et de préparer « l’indispensable transition vers un nouveau modèle de développement, plus durable[17] ». Pour traduire cette ambition, le dispositif piloté par le Commissariat général à l’investissement[18] vise à préserver les 35 milliards d’euros, prévus sur plusieurs années pour la première vague, des aléas des lois de finances annuelles, en consacrant une « gestion extrabudgétaire qui contourne certains aspects de la LOLF », selon l’analyse de la Cour des comptes[19].
Par sa dimension transversale, ses priorités stratégiques et son pilotage par un commissaire placé auprès du Premier ministre, ce « grand plan d’investissement » est sans doute ce qui de nos jours se rapproche le plus de la logique de l’ancien « Plan ». Cependant, du fait même qu’il est inscrit à la marge du reste de l’action publique, dans un lien souvent distendu avec les ministères, on ne peut lui reconnaître le rôle systémique, porteur d’un projet de société, que revêtaient les lois de plan. De plus, les modalités de pilotage de ses appels à projets ne ressemblent pas à l’approche concertée qui était celle du plan.
Coordonner l’action publique : plans, programmes et stratégies
Si « le Plan » n’est plus, l’action publique utilise fréquemment le terme de « plan » (concurremment avec celui de « stratégie » ou de « programme », sans que le choix de tel ou tel vocable soit toujours significatif) pour désigner des projets nationaux qui, malgré leur caractère souvent sectoriel, sont pluriannuels et souvent interministériels.
Parmi les plus récents, certains portent sur le déploiement d’infrastructures, comme le plan « France très haut débit » (2013-2022) ou les trois « plans autisme » et les quatre « plans cancer » successifs (respectivement depuis 2003 et depuis 2005). D’autres visent principalement à définir l’orientation d’une politique ministérielle, comme la « stratégie nationale de santé », la « stratégie nationale de l’enseignement supérieur » ou encore la « stratégie nationale de développement durable ». Certains coordonnent une action intrinsèquement interministérielle ou impliquant un partenariat étroit entre l’État, ses opérateurs et les collectivités locales, comme le « plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale » (2013-2017) et la « stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté », qui lui a succédé en 2018, ou encore le « plan national de mobilisation contre les addictions » (2018-2022). Enfin, on trouve une dernière catégorie de plans d’actions qui établissent des objectifs nationaux et entreprennent de coordonner acteurs publics et privés pour les atteindre : c’est par exemple le cas du « programme national nutrition-santé », des « plans santé au travail », du « plan biodiversité » ou encore de la « stratégie bioéconomie ».
Dans cet ensemble, la « stratégie nationale bas carbone » (SNBC) occupe une place à part. Introduite par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015, elle constitue la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique, donne depuis 2018 des orientations pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte carbone de la consommation des Français. Pour y parvenir, elle définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 2050 et fixe dans chaque secteur d’activité (hors changement d’affectation des terres) des objectifs à court-moyen terme exprimés en « budgets carbone », autrement dit des plafonds d’émissions de gaz à effet de serre, pour les périodes 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033[20]. Ces budgets doivent être « pris en compte » par l’ensemble des décideurs publics, à l’échelle nationale comme territoriale, dans l’élaboration de leurs propres stratégies de limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, ils n’ont pas, par eux-mêmes, de force contraignante.
Paradoxalement, il n’y a jamais eu autant de « plans » que depuis qu’il n’y a plus de « Plan »… Se pose alors nécessairement la question de l’articulation entre les objectifs poursuivis par ces différents plans, comme celle de la coordination des différents acteurs chargés de les animer.
Au-delà et en-deçà de l’État national
Mais la projection de l’action publique dans le long terme ne se fait pas seulement au niveau de l’État-Nation, et c’est sans doute là le bouleversement le plus net par rapport à l’époque de la naissance du Plan. Le processus d’européanisation des politiques publiques a en effet institué le niveau communautaire comme une échelle où s’élabore une approche transversale qui prend différentes formes selon les compétences reconnues à l’Union européenne entre l’intégration, la coopération, et la coordination. Après l’achèvement du marché unique, ce sont toute une série de stratégies (« Lisbonne », « Europe 2020 »), de plans coordonnés (« Plan coordonné en matière d’intelligence artificielle ») de paquets (Paquet « Industrie ») qui tracent des lignes directrices et définissent une voie à suivre par les États membres, chacun à un rythme adapté à sa situation et à ses ressources. En matière de programmation, l’UE conserve cependant une force de frappe budgétaire bien moindre que celle des États membres.
Cette ambition d’une action publique projetée dans le long terme autour d’objectifs généraux déclinés par pays est également portée par différentes institutions internationales, avec par exemple les objectifs de développement durable de l’ONU, avec là encore une capacité assez faible à orienter effectivement l’action des États vers les objectifs définis.
À un niveau infranational cette fois, les dispositifs de planification à moyen terme se sont également profondément transformés par rapport à ce qu’ils étaient à l’époque du Plan. Dès 1963, avec la création de la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR), conçue à l’image du Plan comme une « administration de mission » située auprès du Premier ministre[21], l’État renforce spécifiquement la déclinaison territoriale de son action de planification et son adaptation aux puissants contrastes qui distinguent les différentes régions.
Plus tard, si la décentralisation a participé à fragiliser le Commissariat général du Plan, les « contrats de plan État-région » sont créés en 1982 pour impliquer les élus régionaux dans ce qu’il reste de la logique de la planification. Les sixièmes CPER sont sur le point d’être renouvelés en 2020, et font partie des derniers instruments datant du Plan à avoir gardé leur dénomination initiale – même si le poids de l’échelon régional s’est considérablement renforcé dans leur élaboration.
Cette évolution se traduit notamment par le fait que les collectivités locales (ou leurs regroupements) définissent désormais, dans le cadre de la loi, leurs propres « plans pluriannuels » ou leurs « stratégies de territoire » en fonction de leurs objectifs et de leurs ressources. Là encore les dispositifs ne manquent pas : schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), schéma de cohérence territoriale (SCoT), plan local d’urbanisme communal ou intercommunal (PLU, PLUI), contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP), etc.
On voit ainsi que l’idée même de planification, si elle demeure, est littéralement diffractée entre différents secteurs d’une part et entre différentes échelles d’autre part. Cette évolution va de pair avec une évolution des missions que l’État prend lui-même en charge et se traduit par une transformation des institutions jadis chargées de la conception et de la mise en œuvre du Plan, comme de l’aménagement du territoire.
Des institutions nationales faites pour accompagner, plutôt que piloter
La transition d’un « État stratège » à un État dont l’action consiste davantage à accompagner et à réguler[22] a induit une évolution des missions de ce qu’étaient, notamment, le Commissariat général du Plan et la DATAR.
Lorsqu’en 2012 se pose la question de la réorganisation de l’instance de prospective placée auprès du Premier ministre, le rapport de Yannick Moreau[23] n’envisage aucun retour à une forme de planification. Autour de l’objectif de faire du futur « commissariat général à la stratégie et à la prospective » un « juge d’instruction des problèmes complexes » et l’ensemblier des acteurs de la prospective au service de l’action publique, il lui assigne cinq principales missions : « prospective, stratégie, évaluation, centre de ressources sur les concertations et débats publics et comparaisons internationales et territoriales[24] ».
Concrètement, au cours de ses sept premières années d’existence, le CGSP devenu France Stratégie s’est en effet efforcé d’articuler ces différentes missions par le développement de méthodologies destinées à outiller les décideurs publics et à éclairer le débat public sur les enjeux de moyen terme. Les exercices prospectifs transversaux que sont les rapports Quelle France dans dix ans ?, Quelle action publique pour demain ? ou encore 2017-2027 : enjeux pour une décennie ne constituent cependant pas une reconstitution de l’ambition planificatrice, ne serait-ce que dans la mesure où ils n’ont pas pour aboutissement direct une décision publique.
En particulier, France Stratégie ne coordonne pas l’élaboration ou la mise en œuvre des différents programmes interministériels et pluriannuels évoqués plus haut, mais assure désormais la coordination des travaux d’évaluation qui portent sur plusieurs d’entre eux (France Très haut débit, les premiers volets du Programme d’investissements d’avenir, la Stratégie pauvreté, etc.). Plus largement, elle construit aussi des outils méthodologiques pour la programmation de l’action publique, par ses travaux sur l’évaluation socioéconomique des investissements publics, sur l’évaluation des politiques dites « d’investissement social » ou encore par l’élaboration d’une doctrine pour la définition de la « valeur de l’action pour le climat ». Dans un autre registre, ses travaux, en lien avec la Dares, de « prospective des métiers et des qualifications » ont vocation à servir, entre autres, de point d’appui à la programmation en matière de formation, aussi bien à l’usage des décideurs publics que privés.
Du côté des questions territoriales, la transformation de la DATAR en Commissariat général à l’égalité des territoires (2013), puis en Agence nationale de la cohésion des territoires (2020) traduit également l’évolution de l’administration, d’un rôle de pilote à un rôle d’outillage et d’appui, ici au service des élus et des services des collectivités locales. Son « offre de service » consiste ainsi à « faciliter » le développement des projets conçus à l’échelle et à l’initiative des territoires, dans une logique contractuelle, et non pas à imposer une vision d’ensemble de ce que doit être l’aménagement du territoire de la France.
En somme, l’action publique, telle qu’elle est aujourd’hui conçue et mise en œuvre, se passe d’un « plan d’ensemble » qui intégrerait la totalité des enjeux et des dimensions, misant plutôt sur des outils de programmation thématiques, reliés entre eux par un cadre général centré sur les enjeux budgétaires[25], et sur la régulation plus ou moins rigide des initiatives privées.
Ceux qui en appellent aujourd’hui à un « retour » de la planification suggèrent donc que cette approche ne serait pas adaptée aux défis de notre époque. Il convient alors d’identifier la nature de ces défis qui pourraient justifier de remettre l’idée de « plan » au goût du jour, mais surtout de dresser la liste de tout ce qu’il faudrait impérativement revisiter pour que cette idée soit pertinente. Tel sera l’objet d’un prochain point de vue de France Stratégie.
[1] Voir notamment, selon l’ordre chronologique : « Planification, "révolution des salaires" : les idées-choc du numéro 3 de LR », interview d’Aurélien Pradié dans Libération, le 30 mars 2020 ; « Pour vaincre le coronavirus, vers le grand retour de la planification ? », par Thomas Leroy, sur BFM-business, le 14 avril 2020 ; « Pourquoi ne pas penser aussi à la planification à la française ? », par Philippe Mioche, dans Le Monde, le 17 avril 2020 ; « Médicaments : la planification sanitaire que nous voulons », tribune collective dans Libération le 20 avril 2020 ; « Faut-il recréer le Commissariat général au Plan ? », par Claude Sicard, dans FigaroVox, le 22 avril 2020 ; « L’heure de la planification écologique », par Cédric Durand et Razmig Keucheyan, dans Le Monde diplomatique (mai 2020) ; « La planification doit redevenir non le cadre de toute l’action économique, mais une coopération dans des secteurs clés », par Patrick Weil, dans Le Monde, le 8 mai 2020.
[2] Emmanuel Macron, président de la République, Adresse aux Français, le 13 avril 2020.
[3] Les auteurs de l’article remercient Julie Béneston qui, alors cheffe du bureau des archives de France Stratégie, avait accompli en 2016, à l’occasion des 70 ans du Commissariat général du Plan, un important travail de valorisation des différents « plans », disponibles sur notre site web.
[4] Travaux à paraître, mais dont Patrick Weil livre quelques éléments dans l’article cité plus haut.
[5] Voir à ce sujet Djelic M.-L. (1996), « Genèse et fondements du plan Monnet : l’inspiration américaine », Revue française d’études américaines, n° 68, p. 77-86.
[6] Voir, sur le site de France Stratégie, « Le premier Plan de modernisation et d’équipement ».
[7] Voir de Gaulle J. (1994), L’avenir du Plan et la place de la planification dans la société française, rapport au Premier ministre, La Documentation française (en particulier les pages 20 à 22). Le rapport souligne que les plans suivants, couvrant un domaine plus large et intervenant dans une période où leur exécution dépend davantage de la situation internationale, ont une portée davantage « indicative » et que, par conséquent, « d’un plan à l’autre, la fiabilité des prévisions est inégale et va se dégradant ».
[8] Voir à ce sujet Fourquet F. (1980), Les comptes de la puissance, Histoire de la comptabilité nationale et du Plan, Éditions Recherches, ou encore Terray A. (2017), Des francs-tireurs aux experts. L’organisation de la prévision économique au ministère des Finances, 1948-1968, Igpde, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris.
[9] Monnet J. (1976), Mémoires, Paris, Fayard.
[10] Voir par exemple « Pour une économie concertée », par Albin Chalandon, dans Le Monde, le 8 juin 1960.
[11] Voir, sur le site de France Stratégie, Le quatrième Plan de développement économique et social .
[12] On y lit notamment page 6 : « On peut penser en effet que la société de consommation, que préfigurent certains aspects de la vie américaine et qui a trouvé aux États-Unis ses critiques les plus pénétrants, se tourne à la longue vers des satisfactions futiles, elles-mêmes génératrices de malaise. Sans doute vaudrait-il mieux mettre l’abondance progressive qui s’annonce au service d’une idée moins partielle de l’homme. […] L’occasion doit être saisie d’accomplir une grande œuvre durable au sein de laquelle les hommes vivront mieux ».
[13] Voir, sur le site de France Stratégie : Le cinquième Plan de développement économique et social .
[14] L’article 34 de la Constitution dispose en effet que « des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État ».
[15] Toujours selon l’article 34 : « Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques ».
[16] Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
[17] Voir le rapport Investir pour l’avenir : priorités stratégiques d’investissement et emprunt national, remis par Alain Juppé et Michel Rocard le 19 novembre 2009.
[18] Devenu fin 2017 le Secrétariat général pour l’investissement.
[19] Voir Cour des comptes (2015), Le Programme d’investissements d’avenir. Une démarche exceptionnelle, des dérives à corriger, rapport, décembre.
[20] Ces « budgets » sont inscrits dans le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas carbone.
[21] Voir à ce sujet Bodiguel J. (2006), « La DATAR : quarante ans d'histoire », in Revue française d’administration publique, no 119(3), p. 401-414.
[22] Voir par exemple Billows S. et Viallet-Thévenin S. (2016), « La fin de l’État stratège : La concurrence dans les politiques économiques françaises (1945-2015) », in Gouvernement et action publique, vol. 5(4), pp. 9-22.
[23] Voir Moreau Y. (dir.)(2012), Pour un commissariat général à la stratégie et à la prospective, rapport.
[24] Ibid.
[25] C’est le jugement que porte le rapport de France Stratégie (2015), Quelle action publique pour demain ? 5 objectifs, 5 leviers, sur le bilan de la mise en œuvre de la Loi organique sur les lois de finances (LOLF) de 2020 : « un bon outil, mais qui ne peut servir de substitut à un projet de modernisation », dans la mesure où il n’est adapté ni à la conception ni à l’évaluation de la substance de l’action publique.