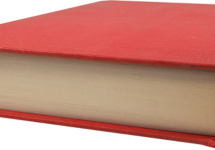L’objet de cette note est de présenter de manière pédagogique et objective les différents arguments, et de faire le point sur les études économiques les plus récentes.
Elle rappelle tout d’abord qu’il n’y a pas de consensus entre économistes sur un niveau de dette publique à ne pas dépasser : c’est plutôt sa stabilité qui importe (en pourcentage du PIB). Ensuite, un déficit public n’est pas synonyme de hausse de la dette en points de PIB. Dans le cas de la France, avec une dette proche de 100 % du PIB et une croissance nominale proche de 3 % par an, la dette exprimée en points de PIB n’augmente pas tant que le déficit public est inférieur à 3 %.
La forte baisse des taux d’intérêt depuis vingt ans a créé peu de marges de manœuvre pour des dépenses supplémentaires puisque la croissance nominale a ralenti en parallèle. Toutefois, depuis
2017, le taux d’intérêt apparent de la dette française est inférieur à la croissance nominale, si bien que la dette publique peut être stabilisée avec un déficit primaire (c’est-à-dire avec un déficit public plus élevé que les seules charges d’intérêt de la dette). En profiter pour relâcher la contrainte budgétaire impliquerait cependant de pouvoir réduire rapidement le déficit primaire, lorsque le taux d’intérêt se rapprochera et repassera au-dessus du taux de croissance du PIB.
Ainsi, les pouvoirs publics doivent arbitrer entre deux risques opposés. D’un côté, ne pas profiter de la situation financière favorable aujourd’hui pour réaliser les investissements nécessaires. De l’autre, perdre le contrôle de la dette publique, si les dépenses ne peuvent pas être ajustées à la baisse lorsque l’écart entre taux d’intérêt et croissance nominale s’estompera, voire s’inversera, sans qu’un consensus se dégage aujourd’hui sur la probabilité ou l’horizon de cet évènement.